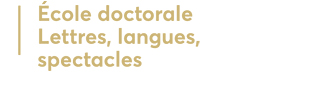Version française / Actualités / Manifestations scientifiques
- Recherche - LLS,
Séminaire doctoral HAR / Cinéma 2024-2025 - Formes de la subversion
Publié le 15 octobre 2024
–
Mis à jour le 29 avril 2025

proposé par Hervé Joubert-Laurencin
Date(s)
du 16 octobre 2024 au 4 juin 2025
Date : 16 octobre 2024, 29 janvier, 19 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai et 4 juin 2025
Durée : 14h
Horaires : 18h à 20h
Format : présentiel
Lieu : Salle Walter Benjamin (INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris)
Public visé : Doctorant.e.s HAR
Type de formation : disciplinaire
Peut-on suivre uniquement certains modules de cette formation ? OUI
Contact : Hervé Joubert-Laurencin hjl@parisnanterre.fr
Formes de la subversion.
Pasolini, Glauber Rocha, Oshima, Fassbinder
Séminaire doctoral des études cinématographiques à Paris Nanterre 2024-2025
proposé par Hervé Joubert-Laurencin
le mercredi de 18h00 à 20h00
salle Walter Benjamin (INHA-r-d-c, 2 rue Vivienne, 75002 Paris)
de janvier à juin 2025 + séance introductive le 16 octobre 2024
Subversion, sédition, transgression
La subversion se vit. Mais elle peut aussi être interrogée comme concept. C’est le premier objectif du séminaire.
Pour cela, elle doit être différenciée de la sédition, à quoi on a cependant toujours avantage à la rattacher en fonction de l’époque considérée car la sédition constitue la forme historique et opératoire de la subversion. Une sédition est un intervalle subversif limité dans le temps et dans l’espace, entre deux moments d’ordre, un moment de lutte qui peut se présenter comme une révolte, une révolution, une répression suivie d’un retour au statu quo ante ou un changement de régime. Mais la subversion doit avant tout être clairement distinguée de la transgression qui, en art, débouche traditionnellement sur le chemin des études formalistes et charrie avec elle une violence apolitique[1] qui la désidéologise.
Le subversif se différencie du transgressif en ceci qu’il ne marche pas dans la combine du pouvoir en place, qu’il refuse de défiler (mais aussi de se défiler). L’histoire des mots le dit : transgression, mais aussi régression et progression, agression et digression, dérivent tous du verbe latin gradi, « marcher », tandis que subversion est, en ce sens, un faux ami : il vient du latin subversio, qui signifie « renversement, destruction », de sub, « en dessous » et vertere, « tourner ». C’est un arrêt contre une action, un surplace qui fait tourner la tête en tournant sur soi-même avec la société entière (le vieux dictionnaire Gaffiot donne en exemple, pour le mot subverto, l’expression « tourner le pied »), éventuellement une marche chorale à plusieurs – une manif – mais jamais la marche en avant du transgresseur, solitaire ou en troupe d’individualistes forcenés conduite par le transgresseur en chef, führer, duce, caudillo, coronel, conducator, timonier. Agresser, c’est « marcher sur » ; digresser, c’est « marcher à côté » ; régresser ou progresser, c’est « marcher en arrière » ou « en avant », c’est-à-dire toujours se trouver également pris dans la compétition de tous contre tous ; la transgression, qui les résume tous avec sa « marche au travers », est ainsi partagée sans difficulté par les libertins et les réactionnaires, les perdants et les décideurs ; pseudo révolutionnaire et pseudo inventive, la transgression fait figure de modèle des rapports de séduction les plus contemporains et les moins subversifs au regard de l’ordre social, qu’ils soient politiques, médiatiques ou artistiques. « Il faut avancer » reste le mot d’ordre le plus frappant de notre génération de décideurs sans arguments (il faut avancer pour que ça marche, ou il faut que ça marche pour avancer), voire construisant des stratégies en contredisant terme à terme, par un opportunisme inversé digne de la « novlangue » théorisée par Georges Orwell, les arguments collectifs et avérés scientifiquement (c’est-à-dire validées collectivement) : la génération des « transgresseurs » est une génération de « marcheurs ».
Dans la sphère culturelle, peut-être la transgression a-t-elle été confortée par l’invention de la télévision (arrivée au milieu des années 1950 en France), premier appareil – qui a vite trouvé son alliance mortifère, indéfectible et autophage, avec la publicité qui a transformé les enquêtes critiques de satisfaction produisant du changement en mesures d’audience justifiant des cercles vicieux – amplificateur d’une transgression tout à fait dénuée de subversion.
Les formes efficaces (morales, éthiques, progressistes) de la subversion sont totalement étrangères à celles apparentes, de pure surface, que sont la provocation, le scandale ou le fait-divers. En résumé, une tentative de définition générale de la subversion sera donc engagée.
Les quatre diables, leur caractère destructeur
Le second objectif du séminaire, ou moyen d’approcher le premier, consistera à appréhender la subversion dans le domaine de la pensée et des formes artistiques, et en particulier dans le cinéma, « art subversif » comme l’affirme le livre classique d’Amos Vogel qui porte ce titre, et qu’Albert Serra, l’un des indéniables cinéastes subversifs contemporains, tient pour le meilleur document de tous les temps sur le sujet et le mieux placé historiquement pour en faire un panorama idéologiquement et historiquement juste[2]. Encore plus précisément à travers les œuvres de quatre « vraies diables, et non faux diables » (comme se définissait Pasolini lui-même[3]) des années 1970 : Pier Paolo Pasolini précisément, Glauber Rocha, Nagisa Oshima et Rainer Werner Fassbinder.
Les œuvres et les vies de ces quatre cinéastes-poètes annoncent, au sein des années 1970, la question contemporaine des fake news, de la mise en scène de soi et de l’exhibitionnisme mercantile des affects. Si les quatre expérimentent par force ces formes apparentes (de la provocation, du scandale et du fait-divers), parfois à leurs dépens, ils ont aussi trouvé des façons inédites de jouer avec elles en les annihilant. C’est là une expérience qui nous importe beaucoup un demi-siècle plus tard, car si ce jeu était déjà vital pour les démocraties, il pouvait encore apparaître comme un jeu, mais il est aujourd’hui devenu une question de vie ou de mort (de la vie collective, de la vie des formes, de la plasticité du vivre ensemble).
Ces quatre hommes, qui ont marqué la décennie 1970 sans s’y limiter, ont des points communs fondamentaux. Ainsi, sous réserve d’inventaire, d’une importance donnée à la poésie sous toutes ses formes (et, justement, en tant que forme mutante apte à définir des modernités) ; à la sexualité (utilisée comme langage et non provocation ou seulement libération) ; à la politique (une même relation théorisée à la révolte et à la révolution) ; à une recherche formelle ; à une lutte, plus ou moins anecdotique ou grave (il est possible que Pasolini en soit mort) contre la censure, qui ne les a pas épargnés.
La subversion répond, dans le Trésor de la Langue Française, à la définition suivante : « Action de bouleverser, de détruire les institutions, les principes, de renverser l'ordre établi. » Il faudra donc trouver, à vouloir l’appliquer dans les arts et au cinéma, le moyen de passer de la seule action à la représentation ou au discours. Le dictionnaire du Cnrs ajoute une citation de L’Homme révolté d’Albert Camus (1951[4]) qui donne cependant quelques pistes et rétablit le mot dans sa positivité : « « [Jusqu’aux grands héritiers du romantisme] ceux qui avaient prétendu agir sur l’événement et sur l’homme, en Occident au moins, l’avaient fait au nom de règles rationnelles. Le surréalisme au contraire, après Rimbaud, a voulu trouver dans la démence et la subversion une règle de construction. » Cet usage camusien de la rébellion-subversion répond à la définition de Sade par Pasolini, qui la complète et la « décolonialise » : « un provocateur merveilleux qui, à travers les Lumières rationnelles, a désacralisé non seulement ce que les Lumières désacralisaient, mais les Lumières elles-mêmes à travers l’usage aberrant et monstrueux de leur rationalité[5]».
Subversōr-ōris signifie en latin, tout simplement : « destructeur ». Le court texte de Walter Benjamin qui prépare les idées de son grand essai, « Expérience et pauvreté » (Die Welt im Wort, n°10, 1ère année, 7 décembre 1933), notamment celle de « barbarie positive », et qui s’intitule, justement, « Le caractère destructeur » (Frankfurter Zeitung, 20 novembre 1931[6]), peut donc faire office de manifeste de la subversion :
Le caractère destructeur ne connaît qu’un seul mot d’ordre : faire de la place ; qu’une seule activité : déblayer. Son besoin d’air frais et d’espace libre est plus fort que toute haine. […] le monde se trouve simplifié dès lors qu’on le considère comme digne de destruction. […] C’est là une vue qui procure au caractère destructeur un spectacle de la plus profonde harmonie.
Le caractère destructeur est toujours d’attaque. Indirectement du moins, c’est la nature qui lui prescrit son rythme ; car il doit la devancer. Faute de quoi, elle se chargera elle-même de la destruction.
Le caractère destructeur n’a aucune idée en tête. Ses besoins sont réduits ; avant tout, il n’a nul besoin de savoir ce qui se substituera à ce qui a été détruit. D’abord, un instant au moins, l’espace vide, la place où l’objet se trouvait, où la victime vivait. On trouvera bien quelqu’un qui en aura besoin sans chercher à l’occuper.
Le caractère destructeur fait son travail et n’évite que la création. De même que le créateur cherche la solitude, le destructeur doit continuellement s’entourer de gens, témoins de son efficacité.
Le caractère destructeur ne souhaite nullement être compris. À ses yeux, tout effort allant dans ce sens est superficiel. Le malentendu ne peut l’atteindre. Au contraire, il le provoque, comme l’ont provoqué les oracles, ces institutions destructrices établies par l’État.
Le caractère destructeur rejoint le front des traditionnalistes. Certains transmettent les choses en les rendant intangibles et en les conservant ; d’autres transmettent les situations en les rendant maniables et en les liquidant. Ce sont ces derniers que l’on appelle les destructeurs.
Le caractère destructeur possède la conscience de l’homme historique, son impulsion fondamentale est une méfiance insurmontable à l’égard du cours des choses, et l’empressement à constater à chaque instant que tout peut mal tourner. De ce fait, le caractère destructeur est la fiabilité même.
Aux yeux du caractère destructeur rien n’est durable. C’est pour cette raison précisément qu’il voit partout des chemins. […] Voyant partout des chemins, il est lui-même toujours à la croisée des chemins. Aucun instant ne peut connaître le suivant. Il démolit ce qui existe, non pour l’amour des décombres, mais pour l’amour du chemin qui les traverse.
Le caractère destructeur n’a pas le sentiment que la vie vaut d’être vécue, mais que le suicide ne vaut pas la peine d’être commis.
[1] Violence qu’on appelait « gratuite » dans les années 1970, en donnant l’exemple de A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971).
[2] Amos Vogel, Le Cinéma, art subversif [New York, Random House, 1974, trad. fr. Dagmar Frégnac, Paris, Buchet Chastel, 1977], Paris, Capricci, 2016, avec une Introduction d’Albert Serra.
[3] Dans le film de Jean-André Fieschi, Pasolini l’enragé (version de 1966 à 45 :20, version de 1992, à 34 :57).
[4] Paris, Gallimard, coll. « NRF ».
[5] Pier Paolo Pasolini, Descriptions de descriptions, nouvelle édition en français, Paris, Manifeste, 2022, p. 272 (nous rétablissons « désacralisaient » qui fait l’objet d’un lapsus dans la traduction de René de Ceccatty).
[6] Les deux articles se trouvent, en français, dans Walter Benjamin, Œuvres II, Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 2000, le premier traduit par Rainer Rochlitz, le second par Pierre Rusch.
PROGRAMME
et présentation du film en cours de réalisation par Marianne Dautrey et Hervé Joubert-Laurencin, Lettre à Glauber Rocha
Durée : 14h
Horaires : 18h à 20h
Format : présentiel
Lieu : Salle Walter Benjamin (INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris)
Public visé : Doctorant.e.s HAR
Type de formation : disciplinaire
Peut-on suivre uniquement certains modules de cette formation ? OUI
Contact : Hervé Joubert-Laurencin hjl@parisnanterre.fr
Formes de la subversion.
Pasolini, Glauber Rocha, Oshima, Fassbinder
Séminaire doctoral des études cinématographiques à Paris Nanterre 2024-2025
proposé par Hervé Joubert-Laurencin
le mercredi de 18h00 à 20h00
salle Walter Benjamin (INHA-r-d-c, 2 rue Vivienne, 75002 Paris)
de janvier à juin 2025 + séance introductive le 16 octobre 2024
Subversion, sédition, transgression
La subversion se vit. Mais elle peut aussi être interrogée comme concept. C’est le premier objectif du séminaire.
Pour cela, elle doit être différenciée de la sédition, à quoi on a cependant toujours avantage à la rattacher en fonction de l’époque considérée car la sédition constitue la forme historique et opératoire de la subversion. Une sédition est un intervalle subversif limité dans le temps et dans l’espace, entre deux moments d’ordre, un moment de lutte qui peut se présenter comme une révolte, une révolution, une répression suivie d’un retour au statu quo ante ou un changement de régime. Mais la subversion doit avant tout être clairement distinguée de la transgression qui, en art, débouche traditionnellement sur le chemin des études formalistes et charrie avec elle une violence apolitique[1] qui la désidéologise.
Le subversif se différencie du transgressif en ceci qu’il ne marche pas dans la combine du pouvoir en place, qu’il refuse de défiler (mais aussi de se défiler). L’histoire des mots le dit : transgression, mais aussi régression et progression, agression et digression, dérivent tous du verbe latin gradi, « marcher », tandis que subversion est, en ce sens, un faux ami : il vient du latin subversio, qui signifie « renversement, destruction », de sub, « en dessous » et vertere, « tourner ». C’est un arrêt contre une action, un surplace qui fait tourner la tête en tournant sur soi-même avec la société entière (le vieux dictionnaire Gaffiot donne en exemple, pour le mot subverto, l’expression « tourner le pied »), éventuellement une marche chorale à plusieurs – une manif – mais jamais la marche en avant du transgresseur, solitaire ou en troupe d’individualistes forcenés conduite par le transgresseur en chef, führer, duce, caudillo, coronel, conducator, timonier. Agresser, c’est « marcher sur » ; digresser, c’est « marcher à côté » ; régresser ou progresser, c’est « marcher en arrière » ou « en avant », c’est-à-dire toujours se trouver également pris dans la compétition de tous contre tous ; la transgression, qui les résume tous avec sa « marche au travers », est ainsi partagée sans difficulté par les libertins et les réactionnaires, les perdants et les décideurs ; pseudo révolutionnaire et pseudo inventive, la transgression fait figure de modèle des rapports de séduction les plus contemporains et les moins subversifs au regard de l’ordre social, qu’ils soient politiques, médiatiques ou artistiques. « Il faut avancer » reste le mot d’ordre le plus frappant de notre génération de décideurs sans arguments (il faut avancer pour que ça marche, ou il faut que ça marche pour avancer), voire construisant des stratégies en contredisant terme à terme, par un opportunisme inversé digne de la « novlangue » théorisée par Georges Orwell, les arguments collectifs et avérés scientifiquement (c’est-à-dire validées collectivement) : la génération des « transgresseurs » est une génération de « marcheurs ».
Dans la sphère culturelle, peut-être la transgression a-t-elle été confortée par l’invention de la télévision (arrivée au milieu des années 1950 en France), premier appareil – qui a vite trouvé son alliance mortifère, indéfectible et autophage, avec la publicité qui a transformé les enquêtes critiques de satisfaction produisant du changement en mesures d’audience justifiant des cercles vicieux – amplificateur d’une transgression tout à fait dénuée de subversion.
Les formes efficaces (morales, éthiques, progressistes) de la subversion sont totalement étrangères à celles apparentes, de pure surface, que sont la provocation, le scandale ou le fait-divers. En résumé, une tentative de définition générale de la subversion sera donc engagée.
Les quatre diables, leur caractère destructeur
Le second objectif du séminaire, ou moyen d’approcher le premier, consistera à appréhender la subversion dans le domaine de la pensée et des formes artistiques, et en particulier dans le cinéma, « art subversif » comme l’affirme le livre classique d’Amos Vogel qui porte ce titre, et qu’Albert Serra, l’un des indéniables cinéastes subversifs contemporains, tient pour le meilleur document de tous les temps sur le sujet et le mieux placé historiquement pour en faire un panorama idéologiquement et historiquement juste[2]. Encore plus précisément à travers les œuvres de quatre « vraies diables, et non faux diables » (comme se définissait Pasolini lui-même[3]) des années 1970 : Pier Paolo Pasolini précisément, Glauber Rocha, Nagisa Oshima et Rainer Werner Fassbinder.
Les œuvres et les vies de ces quatre cinéastes-poètes annoncent, au sein des années 1970, la question contemporaine des fake news, de la mise en scène de soi et de l’exhibitionnisme mercantile des affects. Si les quatre expérimentent par force ces formes apparentes (de la provocation, du scandale et du fait-divers), parfois à leurs dépens, ils ont aussi trouvé des façons inédites de jouer avec elles en les annihilant. C’est là une expérience qui nous importe beaucoup un demi-siècle plus tard, car si ce jeu était déjà vital pour les démocraties, il pouvait encore apparaître comme un jeu, mais il est aujourd’hui devenu une question de vie ou de mort (de la vie collective, de la vie des formes, de la plasticité du vivre ensemble).
Ces quatre hommes, qui ont marqué la décennie 1970 sans s’y limiter, ont des points communs fondamentaux. Ainsi, sous réserve d’inventaire, d’une importance donnée à la poésie sous toutes ses formes (et, justement, en tant que forme mutante apte à définir des modernités) ; à la sexualité (utilisée comme langage et non provocation ou seulement libération) ; à la politique (une même relation théorisée à la révolte et à la révolution) ; à une recherche formelle ; à une lutte, plus ou moins anecdotique ou grave (il est possible que Pasolini en soit mort) contre la censure, qui ne les a pas épargnés.
La subversion répond, dans le Trésor de la Langue Française, à la définition suivante : « Action de bouleverser, de détruire les institutions, les principes, de renverser l'ordre établi. » Il faudra donc trouver, à vouloir l’appliquer dans les arts et au cinéma, le moyen de passer de la seule action à la représentation ou au discours. Le dictionnaire du Cnrs ajoute une citation de L’Homme révolté d’Albert Camus (1951[4]) qui donne cependant quelques pistes et rétablit le mot dans sa positivité : « « [Jusqu’aux grands héritiers du romantisme] ceux qui avaient prétendu agir sur l’événement et sur l’homme, en Occident au moins, l’avaient fait au nom de règles rationnelles. Le surréalisme au contraire, après Rimbaud, a voulu trouver dans la démence et la subversion une règle de construction. » Cet usage camusien de la rébellion-subversion répond à la définition de Sade par Pasolini, qui la complète et la « décolonialise » : « un provocateur merveilleux qui, à travers les Lumières rationnelles, a désacralisé non seulement ce que les Lumières désacralisaient, mais les Lumières elles-mêmes à travers l’usage aberrant et monstrueux de leur rationalité[5]».
Subversōr-ōris signifie en latin, tout simplement : « destructeur ». Le court texte de Walter Benjamin qui prépare les idées de son grand essai, « Expérience et pauvreté » (Die Welt im Wort, n°10, 1ère année, 7 décembre 1933), notamment celle de « barbarie positive », et qui s’intitule, justement, « Le caractère destructeur » (Frankfurter Zeitung, 20 novembre 1931[6]), peut donc faire office de manifeste de la subversion :
Le caractère destructeur ne connaît qu’un seul mot d’ordre : faire de la place ; qu’une seule activité : déblayer. Son besoin d’air frais et d’espace libre est plus fort que toute haine. […] le monde se trouve simplifié dès lors qu’on le considère comme digne de destruction. […] C’est là une vue qui procure au caractère destructeur un spectacle de la plus profonde harmonie.
Le caractère destructeur est toujours d’attaque. Indirectement du moins, c’est la nature qui lui prescrit son rythme ; car il doit la devancer. Faute de quoi, elle se chargera elle-même de la destruction.
Le caractère destructeur n’a aucune idée en tête. Ses besoins sont réduits ; avant tout, il n’a nul besoin de savoir ce qui se substituera à ce qui a été détruit. D’abord, un instant au moins, l’espace vide, la place où l’objet se trouvait, où la victime vivait. On trouvera bien quelqu’un qui en aura besoin sans chercher à l’occuper.
Le caractère destructeur fait son travail et n’évite que la création. De même que le créateur cherche la solitude, le destructeur doit continuellement s’entourer de gens, témoins de son efficacité.
Le caractère destructeur ne souhaite nullement être compris. À ses yeux, tout effort allant dans ce sens est superficiel. Le malentendu ne peut l’atteindre. Au contraire, il le provoque, comme l’ont provoqué les oracles, ces institutions destructrices établies par l’État.
Le caractère destructeur rejoint le front des traditionnalistes. Certains transmettent les choses en les rendant intangibles et en les conservant ; d’autres transmettent les situations en les rendant maniables et en les liquidant. Ce sont ces derniers que l’on appelle les destructeurs.
Le caractère destructeur possède la conscience de l’homme historique, son impulsion fondamentale est une méfiance insurmontable à l’égard du cours des choses, et l’empressement à constater à chaque instant que tout peut mal tourner. De ce fait, le caractère destructeur est la fiabilité même.
Aux yeux du caractère destructeur rien n’est durable. C’est pour cette raison précisément qu’il voit partout des chemins. […] Voyant partout des chemins, il est lui-même toujours à la croisée des chemins. Aucun instant ne peut connaître le suivant. Il démolit ce qui existe, non pour l’amour des décombres, mais pour l’amour du chemin qui les traverse.
Le caractère destructeur n’a pas le sentiment que la vie vaut d’être vécue, mais que le suicide ne vaut pas la peine d’être commis.
[1] Violence qu’on appelait « gratuite » dans les années 1970, en donnant l’exemple de A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971).
[2] Amos Vogel, Le Cinéma, art subversif [New York, Random House, 1974, trad. fr. Dagmar Frégnac, Paris, Buchet Chastel, 1977], Paris, Capricci, 2016, avec une Introduction d’Albert Serra.
[3] Dans le film de Jean-André Fieschi, Pasolini l’enragé (version de 1966 à 45 :20, version de 1992, à 34 :57).
[4] Paris, Gallimard, coll. « NRF ».
[5] Pier Paolo Pasolini, Descriptions de descriptions, nouvelle édition en français, Paris, Manifeste, 2022, p. 272 (nous rétablissons « désacralisaient » qui fait l’objet d’un lapsus dans la traduction de René de Ceccatty).
[6] Les deux articles se trouvent, en français, dans Walter Benjamin, Œuvres II, Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 2000, le premier traduit par Rainer Rochlitz, le second par Pierre Rusch.
PROGRAMME
- Mercredi 16 octobre 2024 (séance préalable introductive)
- Mercredi 29 janvier 2025
- Mercredi 19 février 2025
- Mercredi 12 mars 2025
- Mercredi 02 avril 2025
- Mercredi 14 mai 2025
et présentation du film en cours de réalisation par Marianne Dautrey et Hervé Joubert-Laurencin, Lettre à Glauber Rocha
Mis à jour le 29 avril 2025
Inscription
Aucune inscription requise